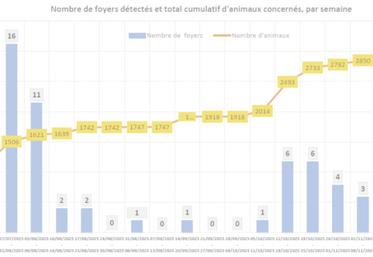Droit de reprise par une société familiale : la Cour de cassation met fin à des années d'incertitude.
À travers un simple congé pour reprise, les juges ont clarifié une question : dans quelles conditions une société familiale peut-elle reprendre des terres louées pour les exploiter elle-même ?

Une affaire typiquement rurale... et pourtant déterminante
Tout commence dans un domaine agricole détenu par une société civile immobilière (SCI) familiale. Une structure comme on en voit beaucoup : créée pour préserver le patrimoine familial, faciliter les successions et éviter les divisions entre héritiers.
Pendant des années, les terres sont louées à une exploitante qui y mène son activité sans heurts.
Mais un jour, les membres de la famille décident de reprendre les parcelles pour les exploiter eux-mêmes, dans le cadre d'un projet agricole collectif. La SCI délivre alors à la locataire un congé pour reprise, comme le prévoit le Code rural. Mais la locataire conteste. Selon elle, la société n'avait pas le droit d'agir ainsi : son objet social n'était pas agricole à la date du congé, et elle ne remplissait pas certaines conditions d'ancienneté imposées par la loi.
Le désaccord prend vite une tournure judiciaire. Les tribunaux de première instance, puis la Cour d'appel, se penchent sur le dossier. Finalement, la Cour de cassation est saisie.
Deux questions au cœur du litige
Derrière cette affaire se cachent deux questions :
Une société peut-elle exercer un droit de reprise si son objet social n'est pas encore agricole au moment de notifier le congé ?
Les sociétés familiales doivent-elles respecter la fameuse "double condition d'ancienneté" prévue à l'article L. 411-60 du Code rural ?
L'évolution du monde agricole en toile de fond
Cette affaire n'arrive pas par hasard. Depuis une trentaine d'années, le visage de la propriété agricole s'est profondément transformé. Les terres ne sont plus détenues uniquement par des exploitants en activité, mais de plus en plus souvent par des familles regroupées en société, que ce soit pour des raisons fiscales, successorales ou patrimoniales. Ces sociétés sont devenues des outils courants pour gérer un bien commun, transmettre sans morceler, et protéger la valeur affective et économique des exploitations.
Mais cette évolution s'accompagne de nouvelles complexités juridiques. Conçu à l'origine pour permettre à un exploitant individuel de reprendre son bien afin de s'y établir, le droit de reprise n'était pas adapté aux structures collectives. La décision de la Cour de cassation vient pallier ce vide juridique.
Premier enseignement : l'objet agricole doit exister dès le congé
La première question posée au juge était simple : à quel moment la société doit-elle avoir un objet agricole ? La SCI en cause pensait pouvoir modifier ses statuts après avoir envoyé le congé, mais avant son entrée en vigueur. Son raisonnement : tant que le changement est effectif avant la date de reprise réelle, il n'y a pas de problème.
La Cour de cassation ne l'a pas entendu ainsi. Elle affirme clairement que le congé est nul si, au moment où il est délivré, la société n'a pas déjà un objet agricole. En d'autres termes, les statuts doivent être à jour dès le départ, avant toute démarche. Pour la SCI, la sanction est sévère : le congé est annulé.
Cette exigence pousse les sociétés familiales à mieux anticiper leurs démarches : il ne suffit pas d'avoir un projet agricole, il faut que ce projet soit juridiquement inscrit dans l'objet même de la société au moment de notifier le congé.
Deuxième enseignement : pas d'ancienneté exigée pour les sociétés familiales
Le second volet de la décision concerne la fameuse double condition d'ancienneté prévue par le Code rural. Selon la loi, une société qui souhaite reprendre un bien loué doit répondre à deux critères :
les biens doivent avoir été apportés à la société depuis au moins neuf ans ;
l'associé exploitant doit détenir ses parts depuis neuf ans lorsqu'elles ont été acquises à titre onéreux.
Mais ces règles connaissent des exceptions pour les sociétés familiales, sans que leur portée soit toujours claire. La Cour de cassation tranche : dans une société familiale, aucune condition d'ancienneté ne s'applique. Ni pour les apports, ni pour la détention des parts.
Autrement dit, lorsqu'une SCI, une EARL ou un Gaec est constitué entre parents proches la loi reconnaît une souplesse spécifique. Cette souplesse vise à encourager la transmission familiale et à éviter que des contraintes formelles bloquent un projet légitime de reprise.
Un message clair adressé aux propriétaires ruraux
Pour les familles détentrices de biens ruraux, cette affaire offre deux enseignements concrets :
Anticiper les démarches : avant de notifier un congé pour reprise, il faut vérifier que les statuts de la société autorisent déjà l'exploitation agricole. Toute modification tardive sera jugée inopérante.
Savoir que la loi protège les projets familiaux : les sociétés constituées entre parents bénéficient d'un régime favorable, sans contrainte d'ancienneté.
Ces rappels paraissent simples, mais ils peuvent éviter de longues procédures et des déceptions coûteuses.
Une clarification bienvenue dans un contexte de relève agricole fragile
Au-delà du cas d'espèce, cette décision résonne avec les grands enjeux actuels de l'agriculture française : la transmission des exploitations, la préservation du foncier et la nécessité de maintenir des exploitants sur le terrain.
Dans un contexte où les départs à la retraite se multiplient et où les jeunes peinent à s'installer, favoriser la reprise par les familles est un levier essentiel.
Les sociétés familiales jouent ici un rôle clé : elles permettent de mutualiser les moyens, de sécuriser les projets et de perpétuer la vocation agricole des terres.
En fixant un cadre clair, la Cour de cassation renforce la confiance des propriétaires dans le droit rural. Mais elle rappelle aussi une vérité souvent oubliée : la forme sociétaire, si utile soit-elle, reste un outil exigeant. Une erreur de rédaction, un oubli dans les statuts, et c'est tout un projet de reprise qui peut s'effondrer.